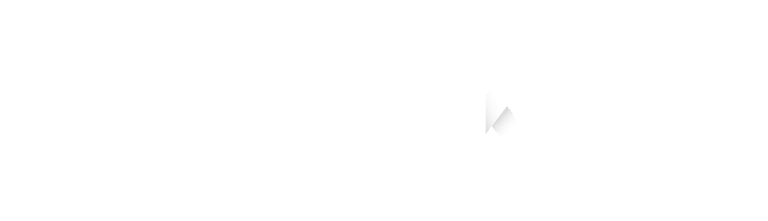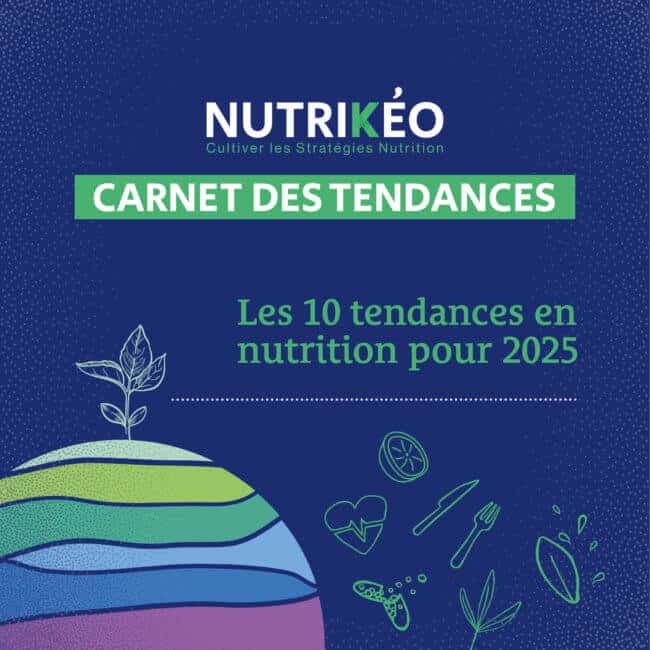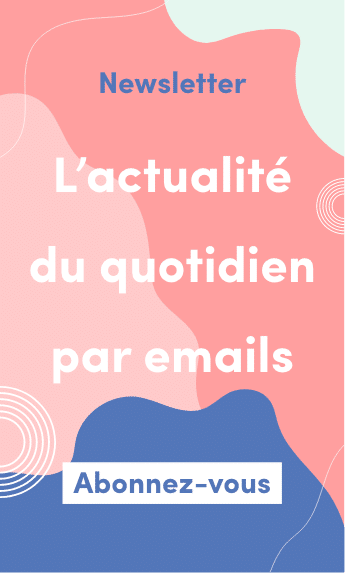Comment parler obésité sans stigmatiser ?
C’est le point de départ de ce travail mené avec une cinquantaine de contributrices et contributeurs par l’Association pour la Santé Publique au Québec (ASPQ), qui a développé sa « trousse pour des communications saines liées au poids ». Sa vocation est de redéfinir la façon dont sont abordés dans l’espace public les trois enjeux identifiés autour du poids par l’association : l’obésité, la préoccupation à l’égard du poids et la grossophobie. Et, pour cela, les outils mis à disposition proposent des conseils sur les pratiques et un vocabulaire adapté pour parler obésité et promouvoir la santé sans stigmatiser. Autant de façons de faire visant à réduire le risque de susciter la grossophobie, de la préoccupation à l’égard du poids et à déconstruire les croyances erronées liées au surpoids.
Quelques exemples de recommandations
Ces recommandations pour parler obésité sont à destination de toutes les personnes amenées à prendre la parole dans l’espace public, des professionnels de santé aux communicants. Nuancer, rester neutre, garder en ligne de mire les saines habitudes de vie : voici les trois incontournables à garder en tête avant de prendre la parole.
Et, concrètement, la trousse propose des exemples d’expression à éviter et des alternatives :

Peut-être connaissez-vous cette phrase d’Albert Camus : « Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde. »[1] ? Elle sous-tend le travail réalisé par l’ASPQ, qui préconise de qualifier différemment mais avec justesse tout ce qui est lié à l’obésité. Mais jusqu’où est-il possible de le faire quand les termes sont directement issus de l’univers médical ?
Les mots versus la réalité médicale
Car l’obésité est une maladie, et la façon de la qualifier répond à des termes établis dans le monde médical. On parle d’obésité lorsque l’Indice de Masse Corporelle (IMC) est supérieur à 30 kg/m2, et d’obésité morbide lorsque l’IMC est supérieur ou égal à 40kg/m2. Cette qualification d’obésité morbide est en quelque sorte réfutée par l’ASPQ, qui propose de l’éviter en justifiant que l’expression « associe l’obésité avec l’adjectif « morbide » qui est péjoratif. »
Une observation objective, mais qui vient contrer le langage médical, et qui nous a amené à nous questionner plus largement sur la qualification des stades de la maladie.
Et si, pour parler obésité, on appliquait la même méthode que pour qualifier les stades d’évolution du cancer, sous forme de numéro ? Parler Obésité de stade 1, 2, 3… règlerait la question de l’emploi d’un terme péjoratif. Quoi qu’il en soit, si nous nous doutons que notre avis ne va révolutionner la terminologie médicale, la démarche de questionnement suggérée par l’ASPQ a totalement trouvé un écho au sein de la rédaction de Culture Nutrition.
Des mots, mais aussi des images
L’association va, par ailleurs, au delà des mots en préconisant également des représentations visuelles positives des personnes grosses, car parler obésité, c’est aussi la montrer. Comment ? En favorisant :
- « des images positives mettant en scène des personnes dans des activités du quotidien »
- « des personnes ayant différentes formes corporelles »
- « des personnes grosses (ou de toute corpulence) adoptant un comportement favorable à la santé »
Cette dernière phrase porte en elle deux points d’intérêt :
- L’utilisation de l’expression « personne grosse » est une recommandation des travaux dont nous parlons. Elle est justifiée par le fait que « Cette expression peut être utilisée de manière neutre pour désigner les personnes ayant une forte corpulence. »
Question de point de vue ou de sensibilité ? Là encore, nous nous sommes posé la question : est-ce que nous (en France), employons facilement l’expression « personne grosse » ? Pas sûr… - Second point d’intérêt, « adoptant un comportement favorable à la santé ». Car parler obésité, c’est parler santé.
L’obésité est une question de santé publique
Selon l’OMS, il y a aujourd’hui plus de 650 millions d’adultes obèses dans le monde, et 1,9 milliards de personnes en surpoids. Pour la France, nous en parlons dans cet article :
Obésité, surpoids, surcharge pondérale ou encore syndrome métabolique : quel que soit le terme employé, c’est une réalité dont les facteurs sont multiples et complexes. Ils ont des répercussions négatives dans le quotidien des personnes concernées, que ce soit sous l’angle de leur santé physique mais aussi mentale. L’initiative de l’ASPQ pour redéfinir les expressions pour parler obésité dans l’espace public a le mérite d’aborder la question sous un angle humanisé, qui nous amène individuellement à nous questionner sur notre rapport aux « corps gros » et à la perception qu’on en a. N’est-ce pas salutaire ?
Crédits photos: #501999260 – ©oneinchpunch – stock.adobe.com
[1] issue du texte intitulé Sur une philosophie de l’expression, publié dans la revue Poésie 44 en 1944.